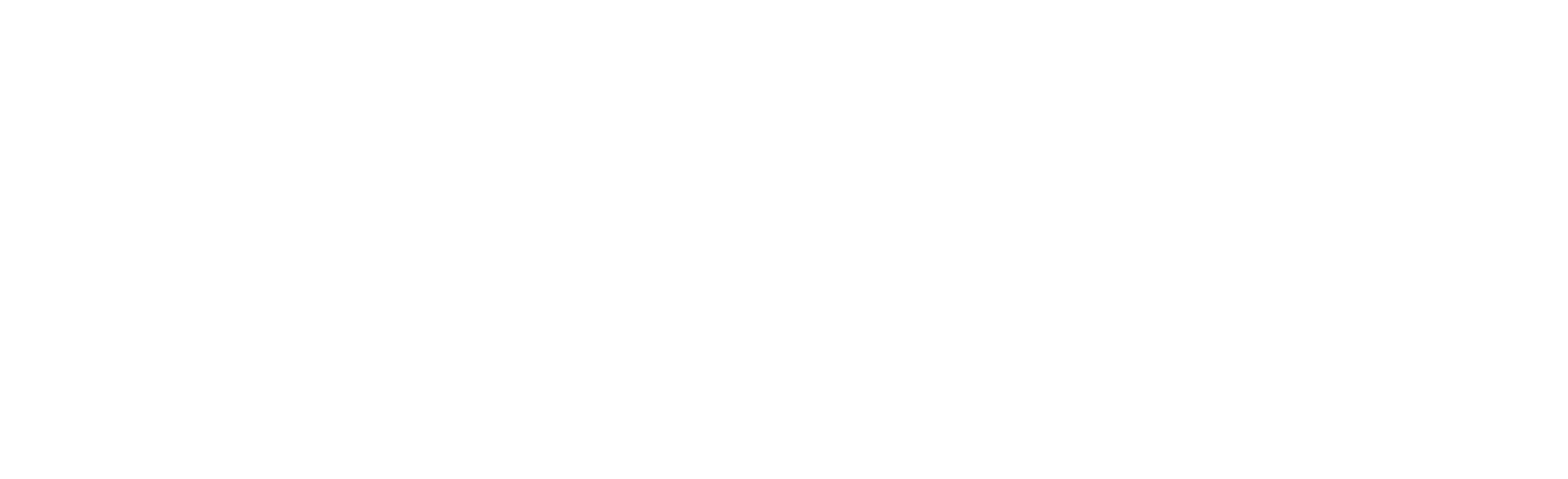La combinaison spatiale n’est pas accompagnée d’un chèque à sept chiffres. L’image colle pourtant à la peau du métier : risqué, rare, héroïque… donc forcément très bien payé. En réalité, le salaire d’un astronaute ressemble davantage à celui d’un ingénieur chevronné de la fonction publique internationale. Il obéit à des grilles, à des règles de déontologie strictes et à une logique simple : on paie des compétences exceptionnelles, pas l’adrénaline. Comprendre comment sont fixés ces salaires, ce qu’ils incluent (ou pas), et pourquoi il n’existe pas de « prime de danger » éclaire un métier souvent fantasmé. Et révèle une idée essentielle : dans l’espace, l’argent n’est pas la fusée qui met les carrières en orbite.
Combien et pourquoi
Du côté européen, les astronautes sont des agents de l’ESA, soumis aux grilles des fonctionnaires internationaux. Les ordres de grandeur sont connus : un astronaute nouvellement nommé se situe autour de 6 200 à 6 900 € nets par mois, après la formation on monte vers 8 500 €, puis 9 000 à 10 000 € après une première mission. « Net » signifie ici exonéré d’impôt national : comme pour d’autres organisations internationales, un prélèvement interne s’applique, mais la paye n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu du pays de résidence. Cela change concrètement le pouvoir d’achat, même si le coût de la vie dans les villes de base (Cologne pour le centre européen des astronautes, par exemple) n’est pas négligeable.
Pas de prime de risque ? Non. La philosophie est d’investir dans la réduction du risque (procédures, entraînement intensif) plutôt que de le rémunérer a posteriori. En revanche, s’ajoutent des éléments classiques de la fonction publique internationale : allocations familiales, indemnités d’expatriation ou de scolarité, couverture santé et assurance invalidité/accident musclée. Autre point clé, souvent méconnu : les astronautes en activité n’exploitent pas commercialement leur image. Pas de contrats publicitaires à la manière des sportifs ; l’éthique de service public prime, pour éviter tout conflit d’intérêts quand on incarne des programmes financés par le contribuable.
Enjeux, comparaisons, réalités
Aux États-Unis, les astronautes de la NASA sont des fonctionnaires fédéraux payés selon un barème appelé « échelle GS », avec rémunération variable selon l’expérience et la localité. Dans les faits, cela place la majorité entre un peu plus de 100.000$ et environ 160.000$, soumis à l’impôt et à la sécurité sociale, avec les avantages du service public américain. Ailleurs, les ordres de grandeur restent comparables à des postes d’ingénierie de haut niveau de la fonction publique : le Japon et le Canada suivent des logiques similaires. La Russie a des niveaux souvent plus bas en valeur absolue, cohérents avec les salaires publics nationaux.
À ce jeu, un pilote de ligne long-courrier senior, un spécialiste cybersécurité ou un chirurgien bien installé peuvent gagner autant, voire plus, avec moins d’aléas personnels et familiaux. Mais la rémunération n’est pas la seule ligne du bilan. La carrière est stable (contrats pérennes, pension), la sécurité sociale est robuste, la formation continue est exceptionnelle, et l’environnement de travail… unique. Côté contraintes, la sélection est impitoyable (taux d’admission infinitésimal), la mobilité imposée, le calendrier imprévisible, la pression énorme. Les missions rapportent des indemnités de déplacement, mais pas de bonus « glamour ». Et l’interdiction de faire de la publicité vaut aussi pour les réseaux sociaux : pas de placement de produit en orbite.
Pourquoi cette sobriété salariale tient-elle la route ? Parce que ces agences défendent un modèle de service public scientifique. Payer « pour le risque » brouillerait le message et créerait des incitations perverses. On préfère rémunérer la compétence vérifiée, l’entraînement et la responsabilité collective. L’effet secondaire est vertueux : on sélectionne des profils motivés par la mission – science, exploration, coopération internationale – plutôt que par la prime.
Ce que l’argent ne dit pas
L’essor du spatial commercial bouscule légèrement la donne. Dans des entreprises comme SpaceX ou Axiom, des équipages privés volent sous contrat, avec des packages de rémunération potentiellement différents. Néanmoins, pour les astronautes d’agences, la structure reste celle d’un grand corps technique public, avec des passerelles possibles vers l’enseignement, la recherche, l’industrie ou le conseil en fin de carrière. C’est souvent à ce moment-là que l’image acquise se monétise via conférences et ouvrages, une fois libéré des obligations déontologiques.
Reste l’équation personnelle. Un salaire d’ingénieur très qualifié, c’est très confortable, mais pas extravagant. Et des années d’entraînement, des compétences rares, et une responsabilité où l’erreur coûte très cher. On ne devient pas astronaute pour « faire fortune », on accepte un contrat social explicite : l’État finance, l’astronaute sert, la société progresse. À l’heure où l’on confond parfois visibilité et valeur, ce métier rappelle une évidence : la rémunération reconnaît la maîtrise, pas la mise en scène.